|
|
|
|
|
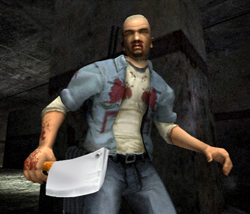
Grand manipulateur, extraordinaire
publicitaire, game designer de génie, Hideo Kojima est le plus
proche parent vidéo-ludique d'Hitchcock. Un concepteur qui, peut-être
davantage que tout autre, a réfléchi sur les implications
(morales, politiques, sociales, philosophiques) et les potentialités
du medium jeu vidéo. Le best-seller MGS2 (PS2, Xbox, PC, 01) a
trompé (et trompe encore) énormément de monde en
faisant passer en contrebande, derrière son allure un peu bovine
de blockbuster, la vision singulière de son auteur. Dans MGS2,
la violence est douloureuse et choquante : lorsque nous abattons pour
la première fois un garde et que celui-ci s'avance, agonisant,
le bras tendu vers nous, une expression presque incrédule sur le
visage, il nous est difficile de ne pas traverser une période de
flottement de quelques secondes, et de ne pas nous demander si nous sommes
effectivement dans le bon camp. Cette dramatisation de chacune de nos
actions sert le propos de Kojima, qui développe une critique des
jeux de guerre et de notre manque de recul envers eux.
Mise
en abyme
Raiden, le soldat débutant
que nous dirigeons, effectue sa première mission sur le terrain,
après des heures d'exercice sur simulateur. Alors que défilent
des images d'entraînements réels et des missions VR (Virtual
Reality) du premier MGS, le héros de la série, Snake, nous
dit : "Ils veulent enlever la peur associée aux situations
de combat réelles. La guerre sous forme de jeu vidéo –quelle
meilleure façon de former le soldat ultime ?". - "Donc
tu penses que les missions VR sont une forme de contrôle de l'esprit
?", demande Raiden. A cet instant, le jeu vidéo entre dans
une nouvelle ère. C'est la première fois qu'un game designer
s'adresse au joueur –en particulier à celui qui a pratiqué
et apprécié MGS1- aussi clairement et aussi directement.
A mesure que le scénario avance, MGS2 se révèle être
une mise en abyme vertigineuse du processus de création et de réception
(identification, interprétation, interactions) d'un jeu vidéo,
qui culmine lors d'un final véritablement hallucinatoire.
Ambiguïté
Manhunt (PS2, 04) adopte
une démarche assez proche de questionnement du jeu vidéo
et de notre relation à l'image. Mettant en scène (littéralement)
un reality-show extrême où il s'agit de tuer des maniaques
qui nous recherchent, si possible de manière ignoble (il faut faire
de l'audience), Manhunt nous place âprement devant la dualité
de notre expérience. Nous sommes à la fois profondément
écoeurés, en tant que spectateurs, par cette extrême
violence graphique et psychologique (la bande-son interactive minimaliste,
l'esthétique granuleuse et poisseuse sont suffocantes), et satisfaits,
en tant qu'acteur, d'être récompensés pour notre maîtrise
progressive des mécaniques de jeu (nouvelles armes -et exécutions
associées-, stages cachés –sachant que plus on parvient
à rester longtemps derrière le dos d'un ennemi sans qu'il
nous remarque, plus l'exécution est horrible, et plus on gagne
d'étoiles pour débloquer les bonus). Le discours réflexif,
crépusculaire et nihiliste de Manhunt aura changé à
jamais le regard d'une pléthore de joueurs (consentants) sur la
violence numérique. On n'a pas fini d'en parler.
>>> Full Spectrum
Warrior, Shellshock
Restituer
l'atrocité de la guerre

Deux
futurs titres paraissent prolonger la voie ouverte par Metal Gear Solid
2 ou Manhunt : celle d'une violence réfléchie, servant un
but émotionnel et sémantique. Full Spectrum Warrior possède,
selon ses créateurs, un "fort message anti-guerre". Le
jeu, qui aspire à "une description authentique de l'horreur
du combat", est "si graveleux, si réel qu'il vous choque
et vous bouleverse" (in Edge 131, p. 50). Ce ne sont pas des paroles
en l'air. La vidéo de démo disponible depuis janvier sur
le Net est absolument tétanisante : la mort d'un coéquipier
en pleine action y est soudaine, imprévisible, brutale (voir image).
Le son de la balle qui pénètre dans le crâne, le sang
qui jaillit, le casque qui tombe, le soldat qui lâche son arme et
s'effondre en arrière… De mémoire de joueur, jamais
la mort n'avait été représentée avec cette
force, cette sécheresse, cette dureté-là dans un
jeu vidéo. Quant à Shellshock, présenté en
reportage ce mois-ci, il semble prendre le parti de représenter
la guerre du Vietnam sans glorification ni poétisation.
|
|
|